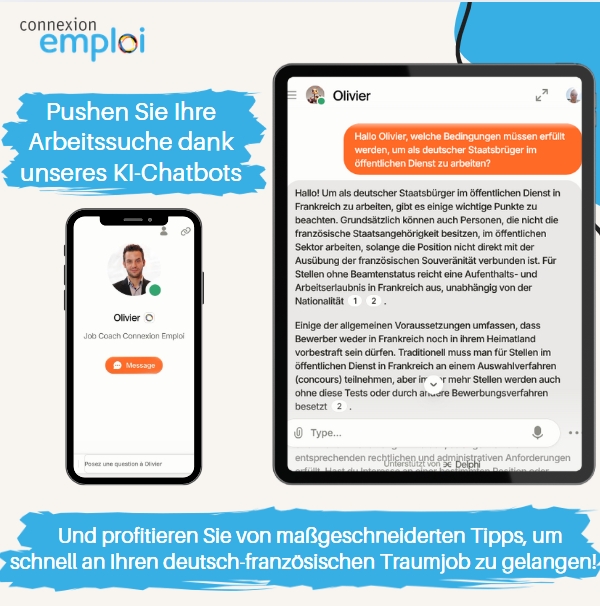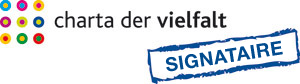Pourquoi l’Église est le premier employeur en Allemagne

Peu de Français l’imaginent, mais le premier employeur en Allemagne n’est pas une entreprise industrielle comme Volkswagen ou Siemens, mais bien… l’Église. Avec plus de 1,4 million de salariés, elle gère un vaste réseau d’hôpitaux, d’écoles, de maisons de retraite et d’associations caritatives. Pour les candidats français en quête d’une carrière à l’étranger, ce secteur représente une opportunité professionnelle unique, notamment dans la santé, l’éducation et le social.
2. Le poids économique et social des institutions religieuses
3. Les secteurs où l’Église recrute en Allemagne
4. Quelles opportunités pour les candidats français ?

En Allemagne, l’Église catholique et protestante se positionne non seulement comme un acteur moral et culturel, mais aussi comme un géant de l’emploi, à même de rivaliser avec les plus grands groupes privés et même l’État. Les chiffres sont parlants : Caritas Deutschland, le principal réseau d’action sociale de l’Église catholique, emploie environ 695 921 salariés (dont près de 81 % de femmes) et mobilise plusieurs centaines de milliers de bénévoles au sein de quelque 25 000 structures dans tout le pays.
Côté protestant, Diakonie Deutschland réunit quelque 627 349 employés, auxquels s’ajoutent environ 700 000 bénévoles, intervenant dans plus de 33 000 services comme les établissements de soins, maisons de retraite et structures sociales . Au total, les deux principales organisations ecclésiastiques emploient plus de 1,3 million de personnes, ce qui les classe deuxième employeur national, juste après l’État.
Ce rôle de leader rencontre une puissance économique impressionnante : selon certaines sources spécialisées, le secteur ecclésial disposerait d’un patrimoine de plus de 500 milliards d’euros et serait à la tête d’un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 125 milliards d’euros.
Les domaines d’activité sont multiples : santé, soins aux personnes âgées, éducation, aide aux réfugiés, accompagnement des jeunes en difficulté, lutte contre l’isolement, ou encore banques alimentaires et programmes d’insertion. Exemple concret : un établissement Caritas peut proposer à la fois des services de soins infirmiers, de consultation sociale, d’accueil d’urgence, tout en bénéficiant du soutien d’un réseau national et d’un financement en partie institutionnel.
Loin d’être une simple institution religieuse, l’Église en Allemagne est un moteur socio-économique majeur, offrant des emplois variés, stables et structurés dans des secteurs essentiels. Pour les candidats français, notamment dans les domaines du social, de la santé ou de l’éducation, c’est une porte d’entrée privilégiée vers un marché du travail inédit en France, et souvent méconnu.

Le rôle de l’Église en Allemagne dépasse largement la sphère spirituelle : elle constitue un pilier du système social et économique. Ce poids repose notamment sur la Kirchensteuer (taxe ecclésiastique), prélevée directement sur le revenu des fidèles, qui représente environ 8 à 9 % de l’impôt sur le revenu. En 2024, cette taxe a rapporté plus de 12,7 milliards d’euros aux Églises, leur permettant de financer écoles, hôpitaux et œuvres sociales à grande échelle.
Grâce à ces ressources, l’Église administre un réseau qui rivalise avec celui de l’État. Au-delà de l’économie, l’impact social est considérable. Dans de nombreuses petites villes, les écoles ou maisons de retraite gérées par l’Église sont souvent le principal employeur local, garantissant stabilité et cohésion sociale. Pendant la crise migratoire de 2015, Caritas et Diakonie ont été en première ligne, ouvrant des centres d’accueil et proposant des programmes d’intégration. Cet engagement illustre le rôle central des Églises : elles ne se contentent pas d’être des employeurs, elles façonnent également la cohésion sociale allemande.

L’Église en Allemagne est l’un des plus gros recruteurs du pays, notamment dans des secteurs en forte tension. Le domaine de la santé et des soins arrive en tête : près d’un hôpital sur trois est géré par une institution ecclésiastique, et la demande en médecins, infirmiers, aides-soignants et psychologues ne cesse de croître. Rien que dans les établissements Caritas, plus de 500 hôpitaux et cliniques accueillent chaque année des millions de patients. De son côté, Diakonie administre plus de 1 000 maisons de retraite, qui recrutent en permanence du personnel soignant.
Le secteur de l’éducation représente aussi un vivier d’emplois. L’Église gère environ 9 000 écoles et crèches à travers l’Allemagne, proposant des postes d’enseignants, d’éducateurs spécialisés et de personnels encadrants. Ces établissements jouent un rôle essentiel dans le système éducatif, notamment dans les régions rurales où ils constituent parfois la seule alternative à l’école publique.
Enfin, le secteur social est un autre domaine clé. Les structures d’accueil pour réfugiés, sans-abri, personnes handicapées ou jeunes en difficulté recrutent régulièrement des travailleurs sociaux, éducateurs, coordinateurs de projets et animateurs. Caritas, par exemple, a accompagné plus de 400 000 réfugiés en 2015-2016, nécessitant une expansion rapide de ses équipes.
À ces emplois de terrain s’ajoutent aussi des postes dans l’administration, la gestion de projets humanitaires, la communication ou encore la finance, indispensables au fonctionnement d’un réseau aussi vaste. Pour les candidats français, cette diversité de métiers signifie qu’il est possible de trouver un emploi dans l’Église allemande, qu’ils soient professionnels de santé, enseignants, éducateurs ou gestionnaires.

Pour les Français souhaitant s’expatrier, l’Église allemande constitue une véritable porte d’entrée vers le marché du travail. Les besoins en personnel de santé et en travailleurs sociaux sont tels que les institutions comme Caritas et Diakonie mènent régulièrement des campagnes de recrutement internationales, notamment en France, en Espagne et en Europe de l’Est.
Les médecins et infirmiers français sont particulièrement recherchés, car l’Allemagne fait face à une pénurie estimée à plus de 50 000 professionnels de santé. Les salaires sont attractifs : un infirmier débutant gagne en moyenne entre 2 800 et 3 200 € brut par mois, soit environ 15 à 20 % de plus qu’en France, tandis qu’un médecin salarié dans un hôpital religieux peut percevoir 5 000 à 7 000 € brut mensuels selon son expérience. De plus, les contrats proposés sont souvent stables (CDI), assortis de formations continues et de perspectives d’évolution.
Au-delà de la santé, l’Église recrute aussi des enseignants, éducateurs spécialisés et animateurs sociaux. Les crèches et écoles catholiques et protestantes recherchent régulièrement du personnel francophone, notamment pour leurs programmes d’ouverture culturelle et linguistique. Les travailleurs sociaux français, réputés pour leur formation solide, trouvent également leur place dans les centres d’accueil pour réfugiés ou dans les structures pour personnes handicapées.
Cependant, il existe une condition incontournable : la maîtrise de l’allemand. Si certaines institutions proposent des cours intensifs avant la prise de poste, un niveau B1-B2 du Cadre européen est souvent requis pour exercer dans le soin, l’éducation ou le social. Pour les candidats motivés, cela peut représenter un investissement initial, mais rapidement rentabilisé grâce aux perspectives professionnelles offertes.
L’Église allemande propose aux Français des emplois variés, bien rémunérés et socialement valorisants, dans des secteurs clés en plein recrutement. Pour ceux qui souhaitent conjuguer carrière internationale et engagement humain, il s’agit d’une opportunité unique en Europe.
En savoir plus:
- Droit du travail de l'Église en Allemagne : quelles obligations pour les salariés ?
- Impôt sur l’église en Allemagne : combien payez-vous et comment l’éviter ?




 Fr
Fr De
De En
En